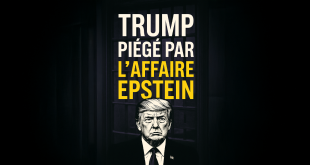Avant d’entrer dans le vif du sujet, plantons le décor. Cet article répond à une vidéo publiée sur la chaîne Le Lab IA de Jérôme Fortias (ici), elle-même une réaction à l’analyse de Monsieur Phi sur Luc Julia (là).
On va donc parler d’arguments d’autorité, de biais bien huilés, de 64 % qui refusent de mourir, et surtout d’une défense de Luc Julia qui, sous couvert d’humilité, flirte dangereusement avec la condescendance.
Le terrain de jeu
Pour comprendre l’ampleur du décalage, il faut d’abord présenter les deux combattants de ce drôle de duel.
D’un côté, Monsieur Phi. Philosophe vidéaste, certes, mais surtout chirurgien du discours. Il ne se présente jamais comme un gourou de l’IA : il connaît ses limites, il cite ses sources, il vérifie ses faits. Il n’a pas la prétention d’être un « praticien », mais il fait ce que bien des praticiens oublient de faire : il lit les articles, il croise les références, et il prend le temps de les expliquer. Ajoutez à ça son humour caustique, et vous obtenez une sorte de combo « professeur d’amphi + stand-up » qui sait à la fois faire rire et réfléchir.
En face, Jérôme Fortias et sa chaîne Le Lab IA. (Oui, « lab », comme si on allait y trouver des chercheurs en blouse blanche pipetant des datasets, alors que c’est surtout du blabla avec un logo.) Fortias est un expert, il le rappelle avec ses collègues tout aussi experts que lui, et autre bien entouré, amis avec PhD à l’appui, comme un bouclier rhétorique. Mais là où Phi sort des faits, Fortias sort surtout des sentiments : il aime, il n’aime pas, il est « mal à l’aise », il trouve ça « déplacé ». Bref, c’est une défense qui s’appuie plus sur l’impression que sur la démonstration.
Et c’est là que réside toute l’asymétrie. Monsieur Phi, armé d’un scalpel, découpe les arguments couche par couche. Fortias, lui, agite une cuillère en bois dans une marmite d’excuses : « c’est la faute des médias », « pourquoi ne pas attaquer d’autres ? », « match nul ». Ce n’est pas un débat, c’est un numéro de contorsionniste.
Comparer les deux vidéos, c’est un peu comme comparer une partie d’échecs avec un concours de bras de fer. Ou comme si vous opposiez un chirurgien cardiaque à un ostéopathe de TikTok. Chacun a ses armes, mais pas du tout sur le même terrain.
Les biais rhétoriques de la défense
La vidéo de Jérôme Fortias (Le Lab IA) n’est pas qu’une défense maladroite : c’est presque un catalogue de biais rhétoriques. À croire qu’il s’est dit « tant qu’à défendre l’indéfendable, autant le faire avec toute la panoplie des sophismes classiques ». Décortiquons.
1. L’argument d’autorité
Premier réflexe : « moi et mes collègues PhD ». Comprenez : j’ai des copains qui ont des diplômes, donc ce que je dis doit être vrai. On est presque dans le « j’ai un ami médecin » version IA. Ce biais est d’autant plus savoureux que Fortias reproche justement à Monsieur Phi de s’appuyer sur des grands noms comme Hinton ou Bengio. La différence ? Phi cite les plus grands chercheurs du domaine, Fortias cite ses collègues de bureau. Match nul, vraiment ?
2. L’homme de paille
Deuxième tour de passe-passe : « pourquoi attaquer Julia et pas Laurent Alexandre, Enthoven ou d’autres ? ». Comme si critiquer un imposteur médiatique obligeait à dresser une liste exhaustive de tous les autres. C’est l’argument « et pourquoi lui et pas l’autre ? », très pratique pour esquiver la critique précise. Spoiler : la vidéo de Phi parlait de Luc Julia. Pas de la totalité du Bottin mondain des bavards médiatiques.
3. La faute aux médias
Troisième ligne de défense : « ce n’est pas Julia, c’est le système médiatique ». Traduction : oui, il exagère, il enjolive, il répète des chiffres faux, mais c’est normal, sinon il ne serait pas invité. On en arrive donc à justifier que mentir (par omission ou par invention) est acceptable, tant que ça permet de rester un « bon client » télé. Avec ce raisonnement, on peut tout excuser : après tout, un astrologue aussi est un bon client médiatique. Faut-il lui confier un comité au Sénat pour autant ?
4. Le biais de confirmation
Enfin, le plus transparent : « Julia est une voix pondérée ». Vraiment ? Il répète des chiffres faux depuis deux ans, confond paramètres et données, se prend pour Napoléon et traite Hinton de vieux gâteux. Si ça, c’est être pondéré, alors Donald Trump est un modèle de nuance. En réalité, ce n’est pas la pondération de Julia que Fortias défend : c’est son propre biais de confirmation. Julia dit ce qu’il a envie d’entendre, donc Julia doit avoir raison.
En résumé
Fortias nous offre une belle démonstration involontaire : quand on manque d’arguments solides, il reste toujours les biais. Ça fait illusion cinq minutes, mais au bout de vingt, ça ressemble surtout à une partie de Monopoly où quelqu’un joue avec ses propres règles.
Les points techniques (où ça coince sévèrement)
Jérôme Fortias ne se contente pas de brandir des biais rhétoriques : il tente aussi de se battre sur le terrain technique. Mauvaise idée. Parce qu’ici, les arguments ne tiennent pas plus longtemps qu’un château de cartes dans un ventilateur.
1. Le mythe des 64 %
Chez Luc Julia, tout commence et tout finit par le chiffre magique : 64 % de pertinence. Un chiffre sorti d’un papier de 2023, mal compris, mal expliqué, obsolète, et répété depuis deux ans comme un mantra. Monsieur Phi a montré en détail pourquoi ce chiffre n’a plus aucun sens : il ne décrit ni la réalité actuelle des modèles, ni même celle de 2023. C’est un vieux ticket de métro présenté comme une carte d’abonnement.
La défense de Fortias ? « Ce n’est pas grave s’il ne met pas à jour ses chiffres, l’IA actuelle est nulle de toute façon. » Donc, en clair : rester figé dans l’erreur devient un signe de clairvoyance. La paresse intellectuelle est recyclée en vertu. Si ça, ce n’est pas de la magie rhétorique, je ne sais pas ce que c’est.
2. Siri, ou l’autoproclamation éternelle
Deuxième terrain miné : Siri. Phi démontre que Julia s’est autoproclamé « co-créateur », alors qu’il est arrivé bien après coup, le temps d’occuper un poste à la tête de l’équipe… avant d’en être remercié. Pas d’insulte, pas de procès d’intention : juste une chronologie et des faits.
La réponse de Fortias ? Déformer les propos de Phi : « il ne nie pas que Julia a travaillé sur Siri, donc pourquoi critiquer ? » Sauf que personne n’a jamais nié que Julia ait travaillé sur Siri. Le problème, c’est qu’il se présente comme co-créateur. Nuance énorme. Éviter le cœur du problème, c’est pratique, mais c’est un peu comme répondre à « il a volé une voiture » par « mais enfin, il sait conduire ».
3. AGI et limites des LLM
Rengaine de Fortias : « on est très loin, calmons-nous, Julia est la voix pondérée ». Problème : les faits récents montrent une évolution rapide, transversale (maths, code, planification, usage d’outils) et agentique (les modèles décident quand et comment enchaîner des actions), qui rend la posture « circulez, y’a rien à voir » intenable.
1) Les modèles ne “recopient” plus : ils raisonnent mieux et s’outillent.
Les séries o d’OpenAI (o3, o4-mini) ont été explicitement entraînées pour « penser plus longtemps », décomposer les problèmes en étapes et utiliser de manière autonome les outils (web, code, fichiers, etc.). Ce n’est pas du vernis marketing : c’est un changement de paradigme qui se voit dans les tâches longues et multi-étapes, domaine où les modèles décident eux-mêmes de la séquence d’actions à mener. OpenAI
2) Les benchmarks de raisonnement “durs” montent nettement.
Sur des épreuves sélectives type AIME/GPQA-Diamond (raisonnement math/scientifique où des PhD plafonnent à ~65 %), les modèles de 2025 (o3/o4-mini) affichent des scores très élevés ; plusieurs synthèses indépendantes confirment l’écart avec les générations précédentes. Autrement dit : on ne parle pas de “quiz de culture G”, mais de raisonnement formel exigeant. Analyse ArtificielleOpenAIPromptLayer
3) Du raisonnement… à la résolution de bugs réels.
Sur SWE-bench et sa variante Verified (tâches de correction end-to-end sur de vrais dépôts open-source), les meilleurs modèles résolvent désormais des tickets que des ingénieurs humains mettent des heures à adresser. Ce n’est pas “du blabla” : le système comprend, modifie le code, exécute des tests et valide. C’est exactement le type de capacité “généraliste” que l’on niait encore hier. OpenAIswebench.comswe-rebench.com
4) Des signaux d’émergence via l’apprentissage par renforcement.
L’exemple DeepSeek-R1 est instructif : en poussant massivement le reinforcement learning, l’équipe observe l’apparition de comportements de raisonnement non programmés explicitement (chaînes de réflexion prolongées, auto-vérification, “aha moments”). On peut discuter des limites, mais balayer ces résultats d’un revers de main n’a rien de “pondéré”. arXivHugging Face
5) Même là où l’IA n’est pas “super-humaine”, elle talonne.
Sur FrontierMath (problèmes de maths de très haut niveau), l’analyse d’Epoch montre des modèles récents surpassant l’équipe humaine moyenne (tout en restant sous le maximum agrégé de toutes les équipes) : non, ce n’est pas “réglé”, mais la marche se réduit rapidement. Affirmer péremptoirement qu’« on est très loin » ne décrit plus la tendance. Epoch AITechRepublic
6) Ce débat n’est pas une lubie d’influenceurs.
Quand des figures comme Hinton et Bengio signent une déclaration appelant à traiter les risques liés à l’IA au rang des pandémies ou du nucléaire, on peut être en désaccord, mais on ne peut pas dire que le sujet est fantasmé. C’est précisément la marque d’un désaccord scientifique sérieux, pas d’une panique médiatique. Center for AI SafetyWIRED
Conclusion de la section.
Peut-on fixer une date pour une “AGI” ? Non. Est-il rigoureux d’ignorer les gains rapides, l’agentisation (outil-use autonome), les résultats sur bugs réels et les signaux d’émergence ? Non plus. Dire « on est très loin » n’est pas un argument ; c’est une posture de confort. Et répétée devant caméras et sénateurs, elle cesse d’être prudente : elle devient politique — en retard d’une itération.
Bref
Sur le terrain technique, Fortias ne défend pas Julia. Il défend surtout l’idée qu’être approximatif, imprécis et à la traîne est acceptable tant que ça « rassure » le public. Un peu comme applaudir un pilote qui se trompe de piste d’atterrissage sous prétexte qu’il n’a pas affolé les passagers.
Les risques qu’on ne peut pas balayer
Se dire « optimiste » en IA ne signifie pas qu’on ferme les yeux sur les risques. Refuser d’y penser au nom d’une pseudo-pondération, c’est confondre le déni avec la sérénité. Or, il existe aujourd’hui des enjeux réels, documentés, qui ne sont pas des fantasmes hollywoodiens.
1) La question des alignements et du contrôle.
Même sans AGI, les modèles actuels sont déjà des systèmes dont les comportements ne sont pas totalement prédictibles. Ils génèrent parfois des raisonnements imprévus, des stratégies de contournement, voire des « hacks » de leurs propres garde-fous. Si l’on délègue à ces systèmes des fonctions critiques (finance, santé, infrastructure), le problème n’est pas de savoir s’ils sont conscients, mais comment garantir leur robustesse et leur alignement avec nos objectifs. Ignorer cette question, c’est jouer à l’apprenti sorcier avec des outils déjà puissants.
2) La dépendance socio-économique.
L’IA n’est pas un gadget : c’est une infrastructure cognitive en train de s’installer partout. Qui contrôle cette infrastructure contrôle l’économie de demain. Les risques ne sont pas seulement techniques, mais géopolitiques : concentration de pouvoir dans quelques entreprises privées, dépendance stratégique des États, vulnérabilité des marchés à des systèmes opaques. Quand Google, OpenAI ou Anthropic orientent leurs priorités, ce sont potentiellement des pans entiers de nos sociétés qui en subissent les conséquences.
3) La disparition (ou affaiblissement) des garde-fous.
Ironie de l’histoire : au moment où les risques deviennent sérieux, certaines grandes entreprises ont… dissous ou licencié leurs équipes spécialisées en sécurité et en éthique de l’IA. L’argument ? Trop coûteux, trop contraignant, pas assez « business friendly ». C’est un signal inquiétant : quand les acteurs majeurs se mettent à privilégier la vitesse de développement au détriment de la réflexion sur les risques, ce n’est pas rassurant, c’est une alerte.
4) Les usages malveillants ou criminels.
Même un modèle « loin de l’AGI » peut déjà servir à automatiser des campagnes de phishing indétectables, à générer du code malveillant, à produire de la désinformation ciblée ou des deepfakes politiques à grande échelle. Les risques ne sont pas hypothétiques : ils sont déjà documentés, et leur coût sociétal peut être massif. Ici encore, dire « calmons-nous, on est loin de Terminator » est une manière de regarder ailleurs.
5) Un enjeu politique, pas seulement technique.
Quand Julia ou Fortias balayent tout ça d’un revers de main, ils ne font pas que donner un avis technique : ils envoient un signal politique. Or, les décideurs — sénateurs, ministres, régulateurs — s’appuient sur ce discours pour calibrer leurs actions. En répétant que « tout va bien, dormez tranquilles », ils participent à retarder des mesures de régulation qui seront, tôt ou tard, indispensables.
En somme :
Reconnaître les risques de l’IA n’implique pas de sombrer dans le catastrophisme. Mais les nier, c’est refuser de voir l’évidence : une technologie capable de transformer aussi profondément l’économie, la sécurité et la vie quotidienne ne peut pas être traitée comme un simple gadget de conférence TED. L’optimisme lucide n’est pas le déni — c’est précisément l’attitude qui oblige à regarder les risques en face pour mieux les anticiper.
La saturation médiatique
Il faut quand même dire les choses franchement : si Luc Julia dérange, ce n’est pas parce qu’il a écrit un livre grand public ou sorti un chiffre approximatif dans une conférence TEDx. Non, c’est parce qu’il squatte tout l’espace médiatique. À la télé, à la radio, devant les sénateurs, dans les journaux : partout, on entend le même refrain. Et ce refrain, c’est toujours le même : « 64 % », « c’est statistique », « on tient le manche du marteau ».
Car oui, Julia a son répertoire, comme un chanteur de karaoké qui ne connaît que trois morceaux. Et bizarrement, il est toujours invité pour les chanter. Pourquoi ? Parce qu’il est le client idéal des médias :
- Il simplifie à outrance.
- Il est clivant et péremptoire.
- Il rassure le grand public en expliquant que « l’IA n’existe pas ».
Bref, il coche toutes les cases d’un bon « produit médiatique ». Et comme on l’entend partout, il finit par devenir la référence par défaut.
Et c’est là que le discours de Jérôme Fortias prend une tournure franchement comique. Il s’offusque qu’on attaque Julia… mais jamais qu’il monopolise le micro. Comme si la vraie injustice, ce n’était pas d’avoir un interlocuteur unique et répétitif, mais de pointer qu’il raconte parfois n’importe quoi.
Résultat, on se retrouve avec une scène absurde : Julia hurle ses « 64 % » en karaoké sur la scène médiatique, faux comme une casserole. Le public s’habitue, les journalistes l’applaudissent parce qu’il fait le show. Et quand un spectateur ose dire « euh, vous entendez bien qu’il chante faux ? », Fortias bondit : « Mais pourquoi l’attaquer lui ? Laissez-le chanter, c’est la faute au karaoké, pas au chanteur ! »
On peut retourner ça dans tous les sens : si Julia occupe le terrain, c’est parce qu’il joue le jeu à fond. Personne ne l’a forcé à répéter des chiffres faux, personne ne l’a obligé à s’autoproclamer co-créateur de Siri. Que ce soit par ego ou par opportunisme, il en profite. Alors oui, critiquer Julia est légitime — parce qu’à force de saturation, son discours devient la bande-son de l’IA en France.
Et rappelons-le : entendre tout le temps quelqu’un ne le rend pas compétent. Sinon, il faudrait admettre que Patrick Sébastien est le plus grand philosophe français, vu le nombre de fois où on l’a entendu chanter « Les sardines ».
Le vrai match nul
Dans sa vidéo, Jérôme Fortias finit par décréter que l’affrontement entre Monsieur Phi et Luc Julia serait un « match nul ». Une formule pratique, qui a l’air équilibrée, presque sage, et qui donne à son auteur le rôle du spectateur impartial. Sauf que… non.
Car soyons sérieux : ce n’est pas un match nul. Ce n’est même pas un match. C’est un duel totalement asymétrique. D’un côté, on a Monsieur Phi, qui pose des arguments vérifiés, des faits sourcés, et un démontage méthodique. De l’autre, on a Fortias, qui explique que « Julia est pondéré, il ne met pas ses chiffres à jour mais c’est normal, et puis de toute façon les médias sont méchants ».
Dire que c’est un « match nul », c’est un peu comme regarder une partie d’échecs et conclure : « Oui bon, d’accord, il a fait échec et mat en 12 coups, mais l’autre a dit qu’il n’aimait pas les dames, alors je dirais égalité. »
En réalité, le verdict est clair : Phi a démonté point par point le discours de Julia. Pas par méchanceté gratuite, pas pour le plaisir de « clasher », mais parce qu’il y avait des erreurs, des approximations et des auto-proclamations qui méritaient d’être relevées.
Qualifier ça de « match nul », c’est une pirouette rhétorique. C’est refuser de reconnaître l’évidence : il y a eu un travail d’un côté, une défense molle de l’autre. Appeler ça une égalité, c’est comme dire qu’un chirurgien et un boucher font « match nul » sous prétexte qu’ils ont tous les deux un couteau à la main.
Conclusion
Au terme de ce petit voyage dans la rhétorique de Jérôme Fortias, le constat est limpide : sa défense de Luc Julia tient plus du réflexe émotionnel que de l’argumentation solide. Entre l’argument d’autorité de comptoir, la faute renvoyée aux médias, les biais de confirmation et la pirouette finale du « match nul », tout son discours ressemble moins à une analyse qu’à une tentative de sauver les apparences.
Mais rappelons-le : la critique ici n’est pas une attaque personnelle. Ni contre Julia, ni contre Fortias. Le problème, c’est l’espace médiatique que Julia occupe, et la façon dont ses approximations façonnent l’opinion publique et influencent les décideurs. Quand on martèle les mêmes chiffres faux et les mêmes slogans sur toutes les antennes, ce n’est plus de la vulgarisation, c’est de la désinformation par saturation. Et ça, ça mérite d’être pointé du doigt, peu importe la sympathie ou l’admiration qu’on peut avoir pour l’homme.
Alors oui, Monsieur Phi n’a sans doute pas envie de répondre à cette vidéo, et il a probablement mieux à faire. Mais laisser passer une telle accumulation de biais et d’excuses sans réaction, ce serait accepter qu’un discours fragile puisse se faire passer pour une vérité équilibrée.
Et pour finir sur une note à la hauteur du sujet : si Luc Julia tient vraiment le manche, comme il aime le répéter, alors ce manche ressemble furieusement à celui d’une pelle… et devinez qui creuse.
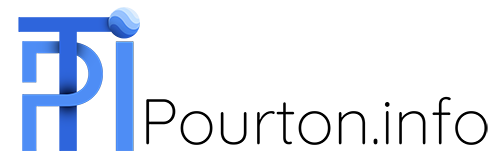 Pourton.info
Pourton.info